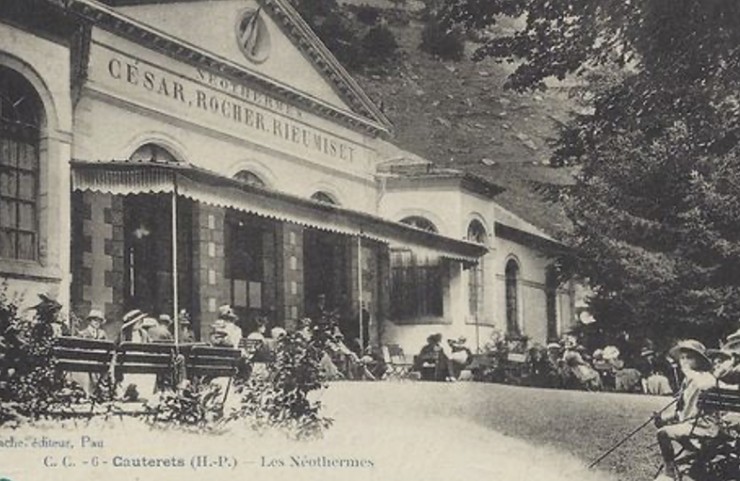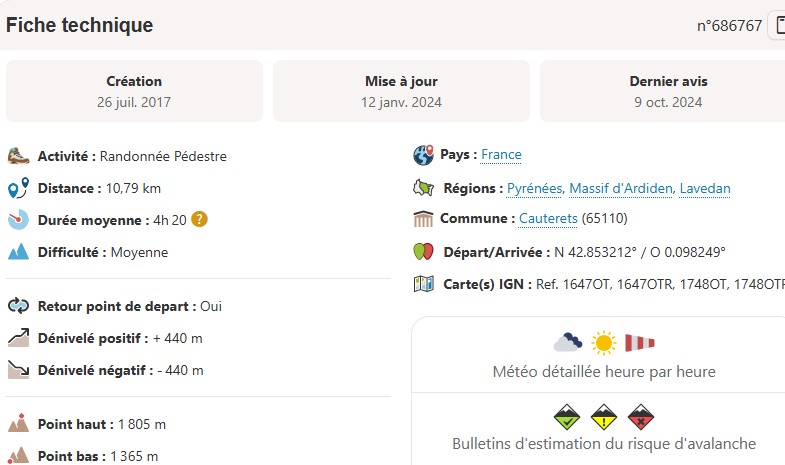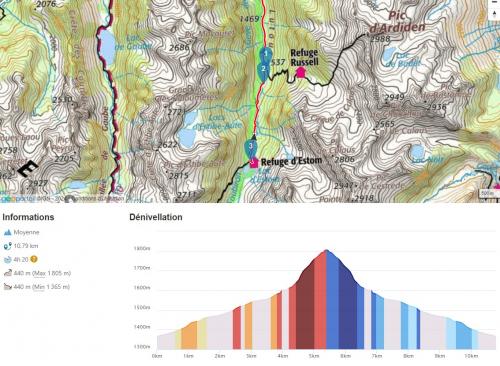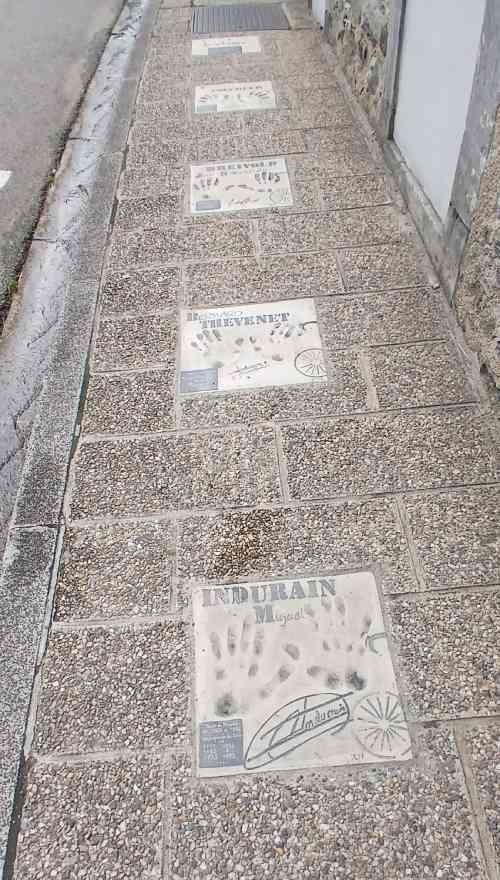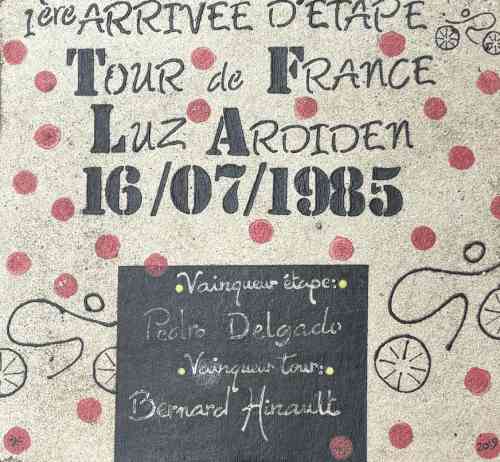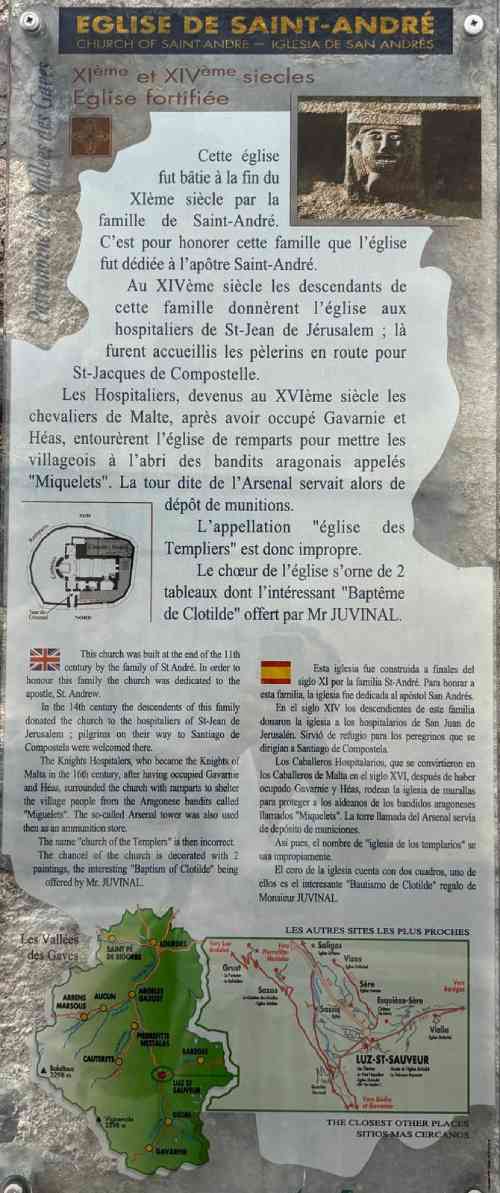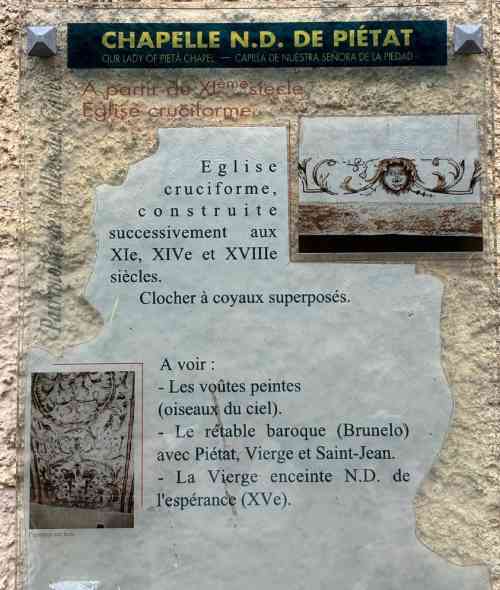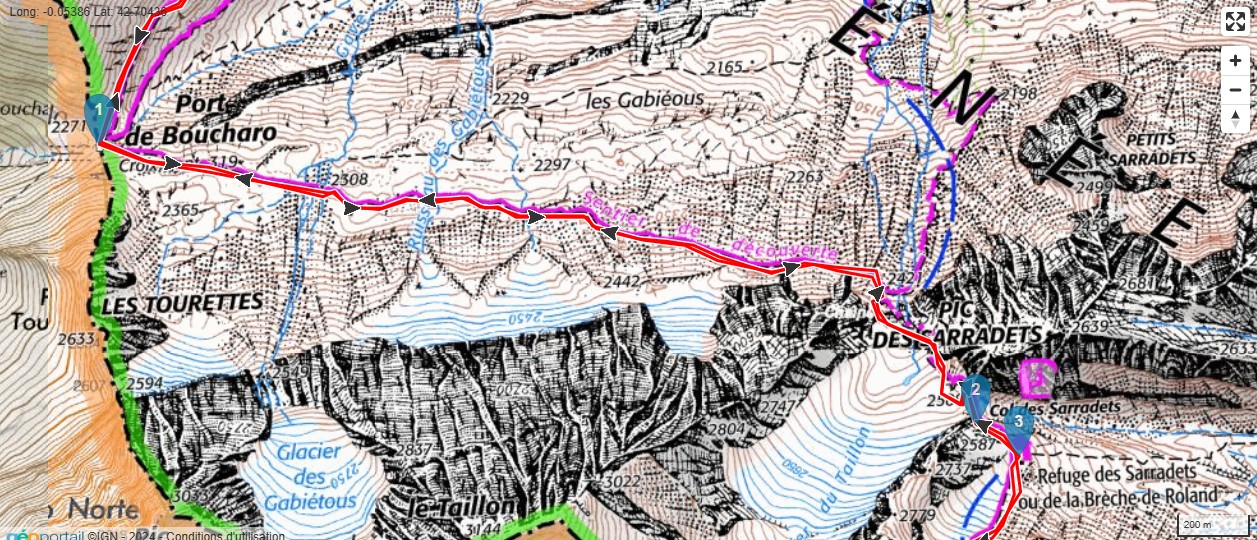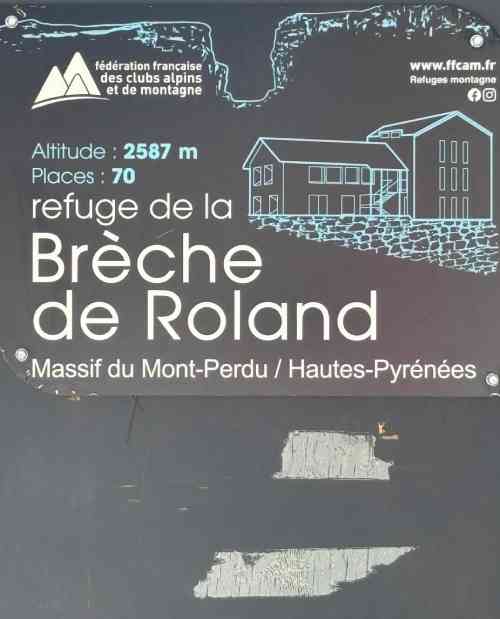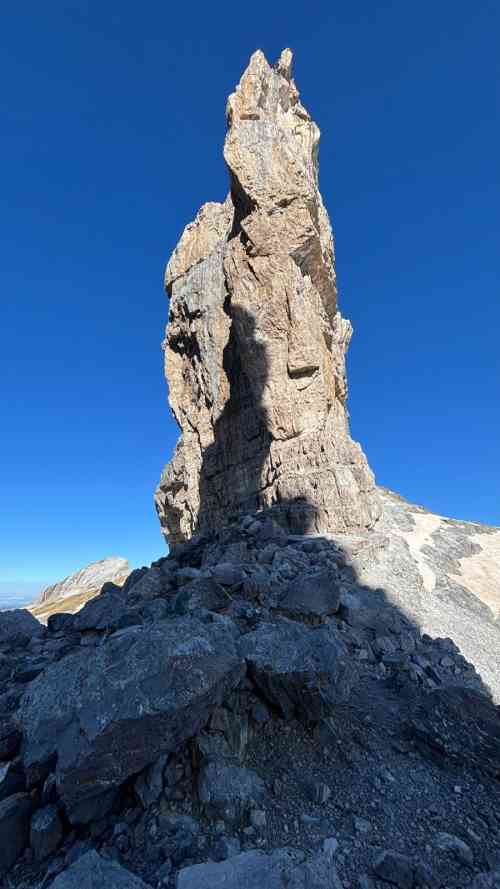|
|
| | | | | | | | | | |
SEJOUR
à
CAUTERETS
5 au 12 juillet 2025 |
|
|
| CAUTERETS Ici et Ici |
 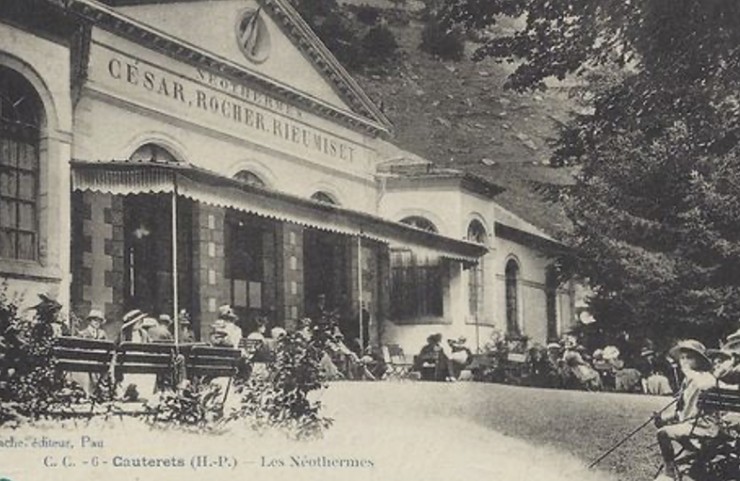 |
Hébergement à Cauterets Ici
Hébergement très bien placé, 2 places de parking sécurisés. 4 chambres. Très bien équipé. |
| EQUIPEMENTS POUR LE SEJOUR : |
Sac
à dos 40 litres (idéal), bâtons, chaussures de montagne (surtout pour
aller à la brèche de Roland car rochers, petit névé possible, ruisseaux
à traverser...). Pour les autres randonnées chaussure de rando plaine
Equipement
chaud (type polaire), poncho ou Kway... gourde, gobelet, set pour
picnic, casquetteet crême solaire, là haut ça tape ! ! ....
Sac à viande pour le refuge - crampons pour les passages en névés |
Parking au Pont d'Espagne : 8 euros
Pour se garer à la Raillère les parkings sont désormais payant (parcmètres) |
| | | | | | | | |
| AU REFUGE DES SARRADETS Ici |
Refuge des Sarradets : 1/2 pension soit 62,50 euros / personne.
Le picnique est à 15 euros.
ATTENTION Le refuge n'accepte que les chèques et espèces |
| | | | | | | | | | |
| LES RANDONNEES AUTOUR DE CAUTERETS Ici |
| La Fruitière -> Lac / Refuge d'Estom |
| Pont d'Espagne -> Refuge Wallon |
| Le Cabaliros | | | | | | | | |
| Le plateau du Lisey | | | | | | | | |
| Le chemin des cascades | | | | | | | | |
| Les balcons de Cauterets | | | | | | | | |
| Le Lac / refuge Ilhéou depuis le Cambasque | | | | | | | | |
| Le refuge des oulettes de Gauge | | | | | | | | |
| Etc... | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| PROGRAMME DU SEJOUR |
| 5 juillet : |
Covoiturage Bordeaux Cauterets : Prise en charge des logements - tour de la ville
Après
midi, petite randonnée depuis Cauterets -> La Raillère -> et
retour par le chemin des pères (2 heures) |
   |
| | | | | | | | | | |
| 6 juillet : |
| Randonnée au Lac d'Estom |
Randonnée depuis la Fruitière au refuge et lac d'Estom Ici
Rando Ici
Randonnée de la journée sans difficulté, très agréable le long du torrent
Départ de la fruitière à 9h00. Picnic sortie du sac au lac. Baignade possible (mais c'est un lac... eau froide ! ! )
Possibilité de boire un café, voire bière... |
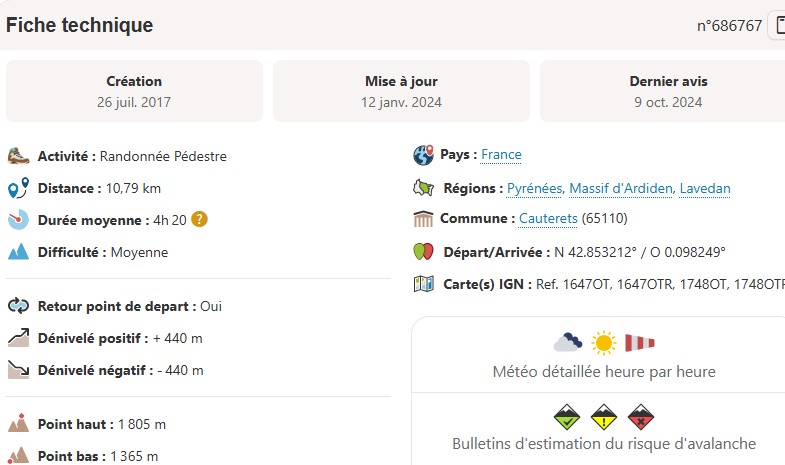 |
 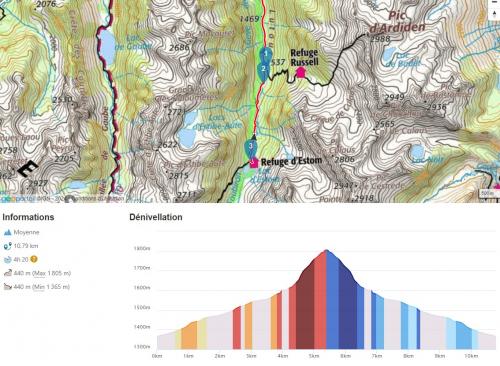 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
  |
| Petite pause en fin de randonnée à la Raillère Ici |
| Faisant
partie du groupe sud, la source de la Raillère est découverte vers 1630
par des bergers venant faire paître leur bétail à proximité du gave. Elle
doit son nom à son environnement extrêmement rocailleux. Rapidement,
sont aménagées sur le site cinq ou six cabanes équipées chacune de deux
baignoires en bois. Les installations sont décrites par le docteur
Jean-François de Borie dans son ouvrage sur les eaux de Cauterets paru
en 1714, puis Théophile de Bordeu en
fait l'éloge dans ses travaux sur les sources pyrénéennes en 1746 où il
préconise la construction d'un hospice. Face au développement du site,
l'intendant d'Etigny commande l'aménagement d'une route reliant le
bourg de Cauterets à la Raillère en 1755, laquelle sera prolongée jusqu'au bain du Bois en 1809 et prendra le nom de Cours de la Reine. Cette
initiative contribue à l'essor du site thermal qui reçoit d'illustres
personnalités mais demeure pourtant vétuste puisqu'il ne comprend à
l'époque que quelques baraques en bois et un bâtiment en pierres nommé
Bain Richelieu. Au regard de son ""misérable état"", un bâtiment
modeste y est d'ailleurs reconstruit à la fin du 18e siècle à
l'initiative du duc de Choiseul, qui avait apprécié y prendre les eaux.
Les bains de la Raillère acquièrent davantage de notoriété encore sous l'influence
du docteur Raymond Castetbert qui, dans son traité sur les eaux
cauterésienne en 1762, évoque les vertus de leurs eaux mais aussi leur
facilité d'accès grâce à la nouvelle route.£Au début du 19e siècle, le
site se compose du bâtiment en pierres et de deux cabanes équipées de
trois baignoires chacune, dont l'une est détruite par un incendie en
1806 et reconstruite provisoirement à la demande du préfet Chazal. Dès
1810 puis à compter de 1816 sur l'impulsion du préfet Milon de Mesne,
plusieurs projets élaborés par divers architectes et ingénieurs (Siret,
Guillot, Rouant, Moisset) sont soumis au Conseil des Bâtiments civils
afin de concevoir un édifice à la hauteur de sa renommée et de l'afflux
de baigneurs. C'est finalement celui de l'ingénieur Siret qui est
validé par l'institution en 1816 et sera exécuté entre 1817 et 1828. Ce
projet consiste en la construction de deux ailes de part et d'autre du
bain Richelieu, démoli plus tard, tandis que l'exécution des travaux et
la concession de l'établissement sont confiés par adjudication à Louis
Pêche puis Pierre François Darripe. Ce bâtiment, ""monument thermal
moderne"" avec son vestibule de marbre et ses installations médicales
innovantes, devient alors le principal établissement de bains de
Cauterets tout au long du 19e siècle. Même les chevaux du Haras de
Tarbes y sont accueillis pour les soins vétérinaires. Entre 1856 et
1863, il subit d'autres travaux sous la direction de l'ingénieur Jules
François et de l'architecte Balagnas et se voit doter de quarante
sièges de baignoire en marbre fournis par l'entreprise Géruzet de
Bagnères-de-Bigorre. En raison d'un
désastreux éboulement survenu en 1884, l'établissement est reconstruit
entre 1887 et 1888 d'après les plans de Jules Gavillon, directeur de la
Société des eaux de Cauterets. C'est de ce chantier que date la
charpente métallique, témoignant du progrès de l'architecture et de
l'ingénierie au tournant du 19e siècle. De part et d'autre du vaste
vestibule abritant une fontaine buvette monumentale, se déploie les
espaces de gargarismes pouvant accueillir jusqu'à 200 malades. Au nord,
est édifiée en 1888 une annexe destinée à recevoir les eaux de la
source du Bois. Le succès de l'établissement, toujours aussi fréquenté,
justifie la création de la ligne de chemin de fer entre le bourg et la
Raillère avec la construction d'une gare spécifique à quelques mètres. L'édifice
fait l'objet de remaniements en 1937 sous la direction des architectes
Jules et Fernand Noutary, avec notamment l'annexe sud. A l'époque, le
complexe se compose des Bains de la Raillère (pavillon central), du Pré
Nouveau (aile nord) et de la Vieille Raillère (aile sud). Malgré son
succès et son entretien régulier, l'établissement doit cesser son
activité dans les années 1980 en raison du risque d'éboulement.
Propriété de la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin depuis
le 17e siècle, il est vendu en 2019 à un privé projetant d'y installer
un centre d'art. |
| L'ancienne gare de la Raillère Ici | | | | | | | | |
 |
La
ligne ferroviaire entre Cauterets et les thermes de la Raillère, mise
en service le 2 août 1897, s’inscrit dans une réflexion plus générale
sur les infrastructures d’accès à ce site menée depuis 1883 Construite
à l'intiative de la Société Lombard-Gérin puis exploitée par la
Compagnie des Chemins de Fer à Traction Electrique de Pierrefitte,
Cauterets et Luz-Saint-Sauveur, et visant à la suppression des omnibus,
cette section a pour unique objectif de conduire les baigneurs depuis
la gare des Œufs du bourg de Cauterets jusqu’aux établissements de
bains situés en amont sur le chemin du Pont de’Espagne, dont le plus
important était celui de la Raillère. Un rapport dressé par l’ingénieur
en chef De Thélin en 1901 précise que cette ligne était exclusivement
destinée aux voyageurs sans bagage et que sa recette atteignait 40.000
francs par an |
| Construite
à peu près au même moment que la gare en bois de Cauterets, la gare de
La Raillère est vraisemblablement projetée par les mêmes ingénieurs
locaux, Pierre Médebielle, ingénieur des Arts et Manufactures, et
Ferrier, ingénieur au service de la Société Lombard-Gérin puis
de la Compagnie des Chemins de Fer à Traction Electrique de
Pierrefitte, Cauterets et Luz-Saint-Sauveur. Sa construction implique
la création du réseau ferré, et donc, d'aménagements spécifiques comme
des ouvrages d’'art (pont, tunnels) et murs de soutènement au cœur des
reliefs escarpés cauterésiens. Quoique fort appréciée par les
curistes pour son cadre pittoresque, avec ses vues imprenables sur les
gaves, les cascades et les sommets environnants, la ligne ferroviaire
est fermée en 1970. Cette gare demeure un témoignage du succès du
thermalisme d’avant-guerre. |
7 juillet - 8 juillet :
|
| Visite de Luz Saint Sauveur |
| Luz Saint Sauveur Ici est connu pour sa station de ski de Luz Ardiden Ici. Mais aussi pour le passage du Tour de France vers le Tourmalet Ici |
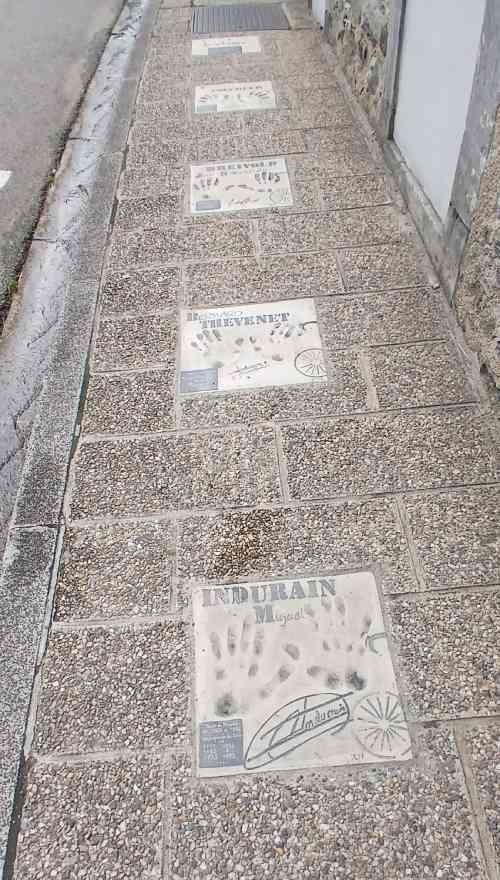 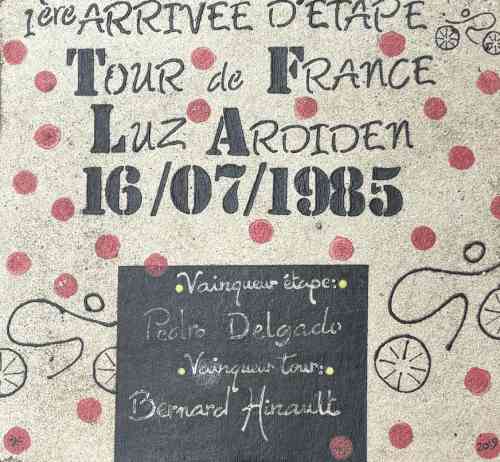
Parmi des coureurs les plus connus et les autres moins connus ayant marqué de leurs empreintes le troittoir de Luz Saint Sauveur |
| L'église fortifiée dite des templiers Ici et Ici et Ici | | | | | | | | |
| De son véritable nom église Saint-André, elle est un des édifices religieux du XIIème siècle en parfait état de conservation. Fortifiée par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem au XIVème siècle - et non par les Templiers
- pour se protéger des troupes de brigands lors de périodes
d’insécurité, elle fut ensuite occupée par l’ordre de Malte au XVIIIème
siècle. Cette église reprend des éléments d’architecture d’une
forteresse du Moyen Âge avec la trace d’un pont-levis, de créneaux, de
meurtrières, de deux tours dont une nommée Arsenal et une deuxième qui
servait de donjon (aujourd’hui dotée d’une horloge). Une voûte
remarquable représentant le Christ et quatre évangélistes orne
l’entrée. |
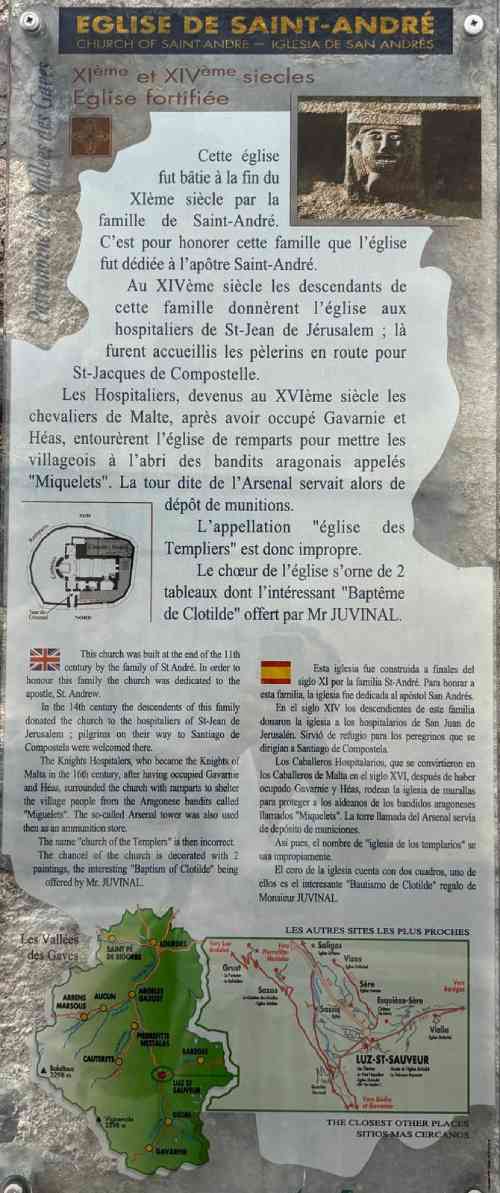 | Dans
l’enceinte des remparts, des tombes attestent de la présence d’un
ancien cimetière. Au niveau du choeur, la voûte dorée montrant
Saint-André auprès de Jésus, le maître-autel et le tabernacle baroques
du XVIIIème siècle, illuminent en toute harmonie les volumes intérieurs
du monument. La Chapelle N.D. de la Pitié, construite au XVIIème siècle
en ex-voto dédiée à la Vierge Marie suite à la terrible peste de 1650,
abrite aujourd’hui le musée du Trésor, lieu d’exposition d’objets d’art
sacré dont les plus anciens datent du XIIIème siècle. Victor Hugo
dessina cette église singulière depuis la fenêtre de sa chambre lors de
son séjour à Luz en 1843
|
 |

- Le tympan roman sculpté de la façade nord.
Éléments remarquables - La voûte peinte du XVIe siècle représentant le Christ entouré des quatre évangélistes (tétramorphe).
- Le maître-autel baroque du XVIIIe siècle.
- Le Musée du trésor, dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié, exposant des objets d'art sacré.
- Un orgue construit en 2011 par la manufacture Koenig qui a la particularité d'être placé à droite du Maître Autel
|
  |
   |

La voûte peinte du XVIe siècle représentant le Christ entouré des quatre évangélistes (tétramorphe) |
| | | | | | | | | | |
| Le Château Sainte Marie Esterre Ici et Ici | | | | | | | | |
Au XIVe siècle, il fut occupé par les Anglais qui en prirent possession jusqu'en 1404, date à laquelle Jean II de Bourbon, comte de Clermont,
aidé par les habitants de la vallée commandés par Aougé de Coufitte,
les chassa et mit fin à l'occupation anglaise de la vallée. Le
château fut ensuite progressivement abandonné. Devant le château se
trouvait autrefois une chapelle nommée prieuré de Sainte-Marie. Vers
1800, la chapelle du château était en ruine et fut détruite. Ses
vestiges sont inscrits sur la liste des monuments historiques en 1930 |
 |
 |
| | | | | | | | | | |
| Visite de Saint Savin |
Saint Savin Ici est une petite commune au dessus d'Argelès Gazost Ici
|
| Saint-Savin, c’est d’abord son abbatiale avec ses médaillons peints au plafond, son orgue et sa chapelle |
  
Le Bourg du village et son abbatiale |
 |
L'ancienne Abbatiale de Saint Savin Ici
Nous avons eu la chance de rencontrer le diacre qui nous a commenté l'histoire de cette abbatiale. |
Fondée
au Xe siècle, cette abbaye bénédictine très influente jusqu’à la
Révolution française, possédait une grande partie de la vallée
d’Argelès-Gazost qu’elle domine.
Aujourd’hui,
demeurent l’imposante abbatiale et la salle capitulaire. A découvrir
dans l’Abbatiale : maître-autel actuel (sarcophage de Saint Savin,
fondateur de l’Abbaye), tympan caractéristique, bénitiers romans,
Christ en croix du XIVe siècle, tableaux peints sur bois (XVe s.)
relatant la vie de Saint Savin et un des plus anciens orgues de France
(1557).
La salle capitulaire (XIIe s.) est un musée d’art sacré contenant des pièces rares |
 |
 |
| | | | | | | | |
 | L'orgue de l'abbatiale Ici
C’est dans ce cadre prestigieux et grandiose qu’est conservé un des plus anciens orgues de France. C’est
sans doute sous l’administration de l’Abbé François de Foix Candale
qu’il fut construit. Une inscription peinte au-dessus du clavier
indique en effet que, et orgue a été
élevé en l’honneur de toute la cour céleste, en l’an 1557 (Hoc organu
factu fuit ad honor[em] totius cursae celestis an[no] 1557)
|

Une particularité :
Les 3 têtes s'articulent au rythme de l'orgue |
  | Le tabernacle
Le ciboire est renfermé dans un cristal de roche et est accessible par une petite porte située à l'arrière du cristal de roche
|
Chapelle Notre Dame de Pietat Ici
| | | | | | | | |
| Située à 800m environ de l'abbatiale, cette
chapelle est construite à l'écart du village. Très peu de
renseignements subsistent sur son origine. Une confrérie de Notre Dame
de Piétat y est attestée à partir de 1493. C'est surtout au XVIIIème
siècle qu'elle va s'agrandir et s'embellir. De cette époque datent le
retable et la belle voûte en bois dite "aux oiseaux". A noter qu'une
partie de la chapelle remonterait à l'époque romane et qu'un vestige de
peinture murale est visible sur le mur de la nef |

 |
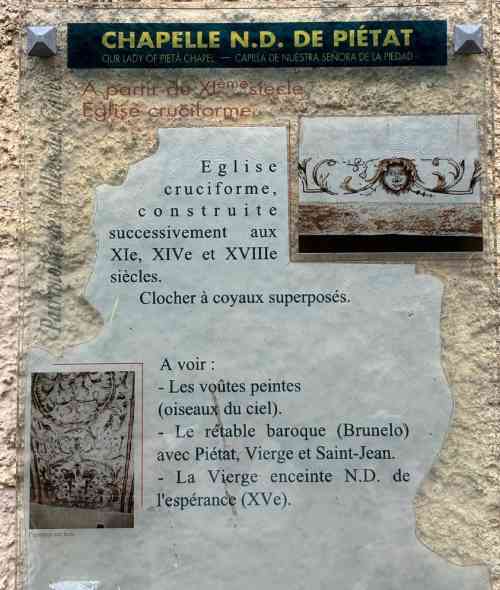   |
 |
 |
| | | | | | | | | | |
| 9
juillet - 10 juillet
| | | | | | | | |
| La brèche de Roland Ici |
Départ Cauterets 9h00
Cauterets -> parking du col de Tentes (Boucharo) 60 km depuis Cauterets.
Col de Tentes -> Refuge des Sarradets (arriver avant 18h00) 5 - 6 heures
Couchage
au refuge des Sarradets ou de la Brèche de Roland 1/2 pension +
picnique à payer sur place soit 77,5 euros.
(Pas de carte de crédit /
chèque ou espèces)
Prévoir sac à viande
Le lendemain matin montée à la brèche de Roland. Il peut y avoir un névé à traverser. Prévoir les crampons
Picnique à la brèche de Roland
Retour à Cauterets ce sera une longue journée
Il faut se garer au col des Tentes |
 |
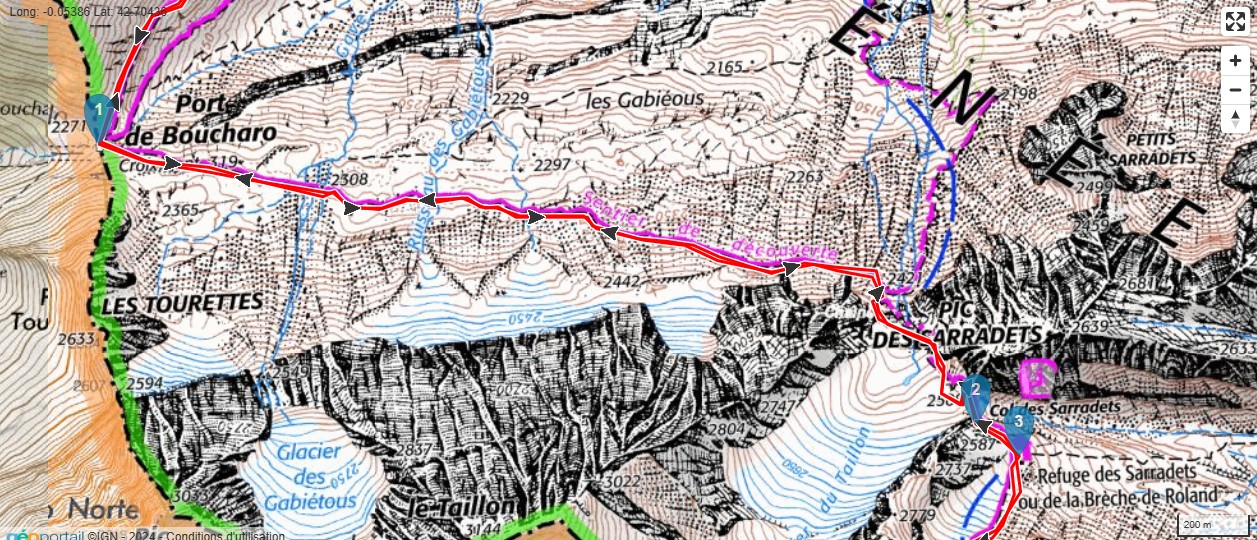  |
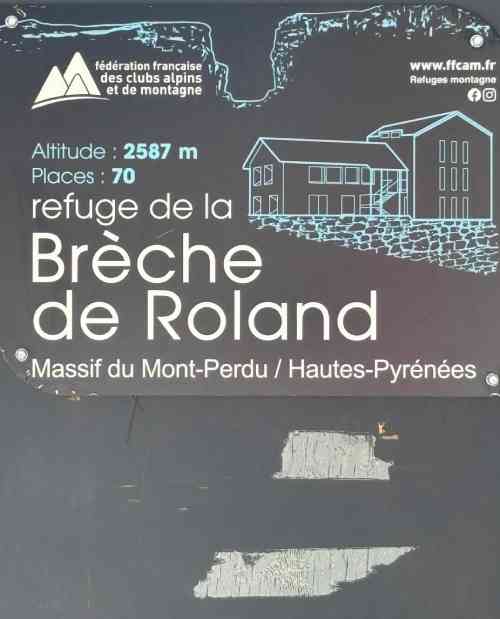   |
 |
 |
 |

 |
 |
 |
   |
 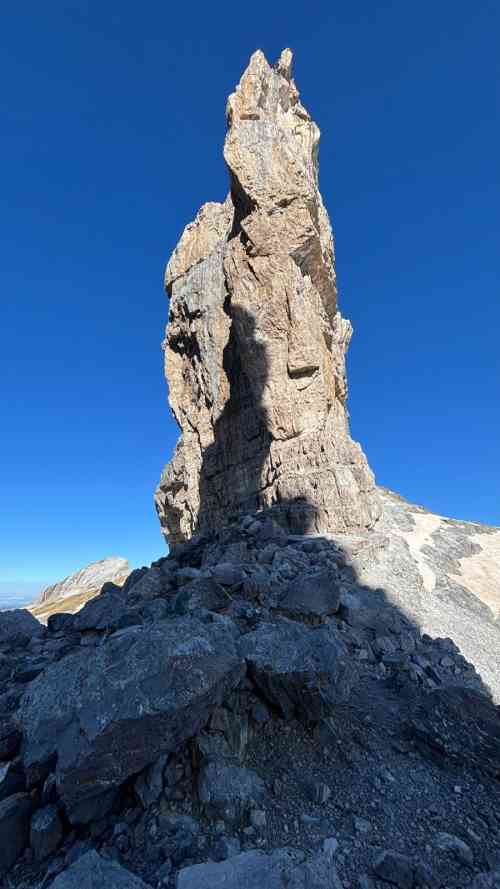  |
| | | | | | | | |
| 11 juillet : | | | | | | | | |
| Randonnée dans la vallée du Marcadau |
| Se garer au pont d'Espagne (parking payant 8 euros pour la journée) |
| Les cascades du Pont d'Espagne Ici |
   |
| La vallée du Marcadau vers le refuge du Marcadau ou refuge Wallon Ici |
 |
   |
 |
 |
| | | | | | | | |
| 12 juillet : | | | | | | | | |
| Retour Bordeaux | | | | | | | | |
|
|